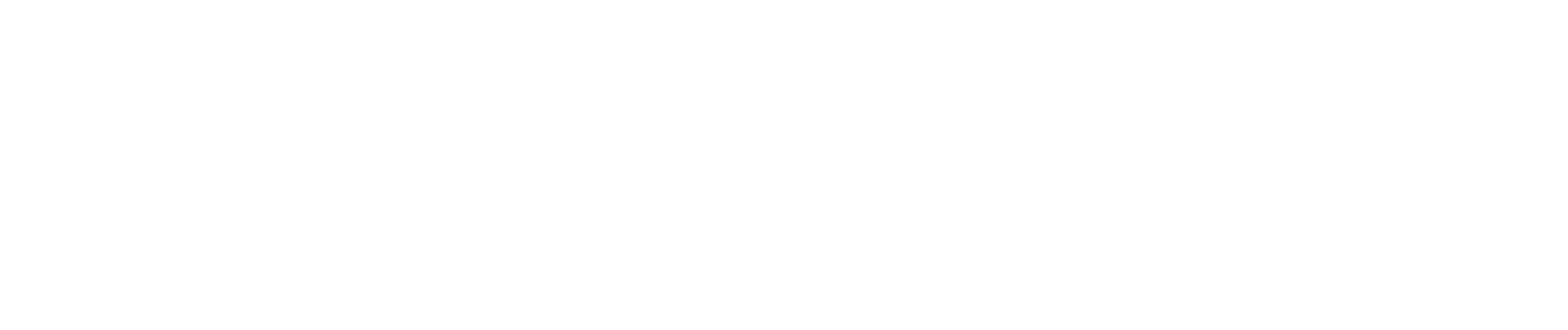Felicia Mihali, pe care am reîntâlnit-o la începutul acestei veri la Montréal – cu ocazia congresului anual organizat de Conseil International d’Etudes Francophones, unde o serie de intervenţii s-au referit la autoarea quebecheză de origine română – face parte din categoria acelor scriitori „migranţi” care, exprimându-se în una din limbile oficiale ale Canadei, aduc un suflu nou în literatura din ţara de adopţie. În provincia francofonă Québec, de care mă leagă preocupări profesionale, dar şi legături afective, aceştia contribuie la apariţia unui nou canon literar, în care interculturalul, metisajul şi nostalgia rădăcinilor reprezintă axe majore de reflecţie. Fie că vin din Orient ( irakianul Naim Khattan sau chinezoaicaYing Chen), din Europa de Est (Alice Parizeau/Alicja Poznanska, Polonia), din America Latină (brazilianul Sergio Kokis) sau din Antile (G. Etienne, Danny Laferrière), „migranţii” aduc, prin scrieri publicate în noua lor limbă, la edituri de prestigiu din la belle province, o „sensibilitate particulară” , puternic impregnată de raportul identitate/alteritate, de spirit transcultural.
Autoare a unor romane care au lansat-o în România în perioada când era jurnalist cultural în capitală, Felicia Mihali a emigrat în Canada acum zece ani, cu toate că Tara brînzei (1998), Mica istorie, ( 1999) şi Eu, Luca şi chinezul (2000) s-au bucurat de o foarte bună receptare critică, Alex Ştefănescu numind-o „un scriitor de 24 de carate”. La Montréal a reluat studiile universitare, obţinând o licenţă şi apoi o diplomă de master în domeniul literaturii postcoloniale. Diverse burse primite din partea generosului Conseil des arts et des lettres du Québec i-au permis să scrie în anii care au urmat o serie de romane publicate de XYZ Editeur, una dintre editurile de prestigiu din Montréal, romane ce au consacrat-o deja ca pe un nume de referinţă: Le Pays du fromage ( traducere a volumului de debut, 2002), Luc, le Chinois et moi ( 2004), La reine et le soldat ( 2005), Sweet, sweet China (2007), Dina (2008), Confession pour un ordinateur (2009).
În tihna din casa ei, de pe o stradă liniştită din insula Laval, la doar o jumătate de oră de Montreal, Felicia Mihali a primit ideea acestui interviu, cu aceeaşi amabilitate cu care şi-a primit invitaţii, universitari de origine română risipiţi prin toate colţurile lumii, la o masă îmbelşugată, cu miresme de Bărăgan şi de câmpii olteneşti. Răspunsurile au venit la începutul toamnei, din Schefferville, unde prozatoarea va petrece un an ca profesor de limba franceza in comunitatea autohtona Innu.
Elena Brandusa Steiciuc: – Când v-aţi hotărât să plecaţi din România, acum 10 ani, nu eraţi o necunoscută, ci o tânără autoare deja remarcată de critici, în plină afirmare, după cele trei romane. Cu riscul de a vă adresa o întrebare care se pune de obicei tuturor celor care, la un moment dat al existenţei lor, aleg să trăiască în altă ţară, o întrebare banală şi poate chiar nepoliticoasă, vă voi întreba totuşi: ce anume v-a determinat să treceţi oceanul şi să vă instalaţi în Canada? Şi, mai ales, ca scriitor, cum aţi suportat trecerea de la limba Dvs. maternă, în care aţi scris până în acel moment, spre o altă limbă de creaţie?Aţi bănuit că acest eveniment biografic avea să declanşeze geneza operei Dvs. de limbă franceză?
Felicia Mihali : Exista citeva elemente esentiale, legate de biografia mea, care m-au indemnat sa parasesc Romania. In primul rind, dupa efervescenta si sperantele pe care ni le-am pus in schimbarea de dupa caderea comunismului, a urmat dezamagirea ca noi ca natiune nu avem resursele sa trecem prea usor peste un proces care ne-a exacerbarea cele mai rele trasaturi de caracter. A fost poate un gest de lasitate, ca un sobolan care se salveaza de pe o corabie pe cale sa se scufunde. Dar Romania mi se pare uneori o tara care poate fi iubita si servita numai de la distanta. Dincolo de aceste motive de ordin fizic, exista de asemenea unul de ordin metafizic. Cred ca fac parte din acea categorie de imigranti metafizici de care vorbea Adorno, care nu sint acasa niciunde. De fapt a schimba nationalitatea nu inseamna o schimbare de identitate, care este inscrisa in codul tau genetic si care te urmareste oriunde ai fi, ca propria umbra. In Canada am devenit mai profund romanca decit am fost vreodata in cei 33 de ani petrecuti acasa. Si in fine, cred ca marele motif a fost dorinta de a evolua, de a gasi noi surse de inspiratie pentru cartile mele. Celebritatea de scriitor de care vorbiti nu m-a atins prea tare in Romania. Poate ca intr-un fel venea prea tirziu pentru mine ca sa ma entuziasmeze. Dar in esenta, notorietatea este extrem de periculoasa, si pot numi o serie de autori care o data celebri nu au mai dat o singura carte acceptabila, din cauza stagnarii in propria lor formula cistigatoare. Cartile mele sint extrem de biografice, chiar si cele care vorbesc despre regina Persiei sau despre o concubina din dinastia chineza Ming. Senzatiile, trairile personajelor mele se hranesc profund din experienta mea cotidiana, ori migratia este o stare in care esti zilnic sub atacul noutatii, al necunoscutului. Adaptarea la noul mediu iti impune o lupta continua cu propriile limite. Din punctul meu de vedere, acesta este terenul cel mai fertil pentru un creator.
E.B.S : – Primele romane pe care le-aţi publicat în Canada sunt, de fapt, traduceri ale romanelor scrise în România, Ţara brânzei et Eu, Luca, chinezul. Ne interesează cazul acesta special al autorilor (românul Panait Istrati mai de mult, grecul Vassilis Alexakis în zilele noastre) care îşi traduc propriile texte, de multe ori remodelându-le, rescriindu-le în limba-ţintă, ajungând la texte aproape diferite de cele din limba-sursă. Ce ne puteţi spune despre experienţa autotraducerii în cazul Dvs. ?
F.M :- Cind am plecat din Romania nu am prevazut toate dificultatile pe care schimbarea de limba le presupune pentru un autor. Astazi, acest traseu mi se pare atit de spinos incit as sfatui pe orice autor sa nu faca acest pas decit daca e neaparat necesar. Unealta cea mai importanta pentru un scriitor este limba, ori imigratia distruge tocmai acest pod intre tine si limba materna. Noua limba este un tarim extrem de neospitalier, o padure plina de hatisuri in spatele caruia te pindesc nenumarate primejdii. Procesul de a te recrea ca autor intr-o noua limba necesita mari eforturi si mai ales multe renuntari. Cred ca un autor nu va fi niciodat capabil de aceleasi performante intr-o limba de imprumut, mai ales dupa o anumita virsta cum a fost cazul meu. Textul nou creat este mai putin coerent si mai spinos. Dar daca forma e mai saraca, continutul trebuie sa fie mai bogat. Este singura salvare. Daca acest lucru nu se realizeza, continutul in detrimentul formei, un autor este victima celui mai penibil esec. Exista autori care viseaza sa revolutioneze limba de imprumut. Nu e cazul meu. Franceza mea e tot atit de concisa si de simpla ca si romana mea, formata intr-o redactie de jurnal. Faptul ca am fost mai inainte de toate ziarist ramine avantajul si dezavantajul meu. In ceea ce priveste noua mea cariera de autor francofon, exista inca persoane care ma acuza de aceasta alegere. Numai ca aceasta decizie a fost o necesitate. Daca vrei sa publici in noua ta tara nu ai de ales decit sa ii imprumuti limba. Eu am inceput sa imi traduc cartile imediat dupa ce am sosit la Montreal, ca un paleatif contra depresiei de a ma trezi intr-un loc cu care nu aveam nici o legatura afectiva. Cartile mele era tot ce aveam mai important in bagajele de imigrant, singura dovada a unei identitati care refuza sa se lase anihilate. Numai ca recitindu-le in apartamentul minuscul unde ne-am instalat dupa aterizare, descopeream cu tristete ca nu le mai iubeam. Din fericire trecerea in franceza le-a dat un nou suflu, le-a reincarcat de mister. Intilnirea cu noua limba s-a realizat pentru mine prin intermediul propriilor mele romane. A fost o intilnire plina de conflicte, caci tot ce mi se parea atit de bine realizat in romana nu avea nici un farmec in franceza. Dar pe masura ce avansam, descopeream ca noua limba are si avantaje, fiind mai concisa si chiar mai evocatoare. Orice autor stie ca o traducere este o pierdere, dar partea buna este ca exista totdeauna si un cistig.
E.B.S: – Primul roman scris direct în franceză a fost La reine et le soldat (2005), un roman istoric numai în aparenţă. Aici reconstituiţi lumea antică, Persia cucerită de Alexandru cel Mare şi toate mutaţiile pe care acest eveniment le declanşează în Orient şi în Occident deopotrivă. Pe fundalul acesta se petrece povestea de dragoste dintre regina Sisyggambris, mama regelui Darius, învins de ilustrul macedonean, şi tânărul soldat Polystratus, vrăjit de rafinamentul oriental, tot aşa cum bătrâna femeie este sedusă de puterea virilă venită din Occident. Dar Regina şi soldatul este şi spaţiul unui joc permanent între trecut şi prezent, al unei viziuni ironice şi lucide asupra evenimentelor de actualitate, cum ar fi, de exemplu, războiul din Irak („Alexandru elibera popoare ce nu voiau să fie eliberate. Cei care înaintează prea mult pe teritoriul altora nu pot fi nicidecum numiţi eliberatori”, p. 139). Să fie, oare, teribilul clash între Orient şi Occident elementul declanşator al acestui fascinant roman?
F.M: Geneza acestui roman se intinde pe o perioada extrem de lunga. Creatia lui a inceput in Romania, pe vremea cind eram studenta la olandeza, si s-a accelerat dupa 11 Septembrie. Evident, scriitura a demarat ca un tribut al campaniei lui Alexandru cel Mare in Asia. Viziunea glorioasa asupra tinarului rege este una din constantele cele mai solide ale culturii europene. Se vorbeste inca la satietate de rolul lui Alexandru la transmiterea elenismului in Asia, uitind ca Alexandru era un Macedonean detestat in Helada, caci in drumul sau spre Atena a ras Teba de pe fata pamintului. Campania lui Alexandru a fost alimentata de conflictul cu tatal sau Filip, de orgoliul mamei sale Olimpia si de setea de aventura insuflata de Aristotel, pedagogul tinarului print. Nimic rau in toate astea, pina la faptul ca aventura sa razboinica si spirituala a fost scump platita de popoare si de cetati infloritoare, unele dintre ele de-a dreptul anihilate. In drumul sau spre Indus, tinarul rege, devenir un tiran, betiv pe deasupra, a permis crime, jafuri, masacruri, violuri de neimaginat. Din campania lui Alexandru in Asia nu au rams decit citeva toponime, iar gloria sa este datorata faptului ca istoria este scrisa de invingatori. Pentru a cuceri si distruge nu ai nevoie decit de un pretext insignifiant. Din perspectiva moderna, campania de acum 2300 de ani nu se deosebeste prea mult de invazia Irakului. Problema este ca democratia nu poate fi exportata, in primul rind pentru ca umanitatea este extrem de diversa si traieste dupa coduri ancestrale complexe. Un occidental accepta greu ca ceea ce e bine pentru el si functioneaza perfect intr-un spatiu dat intra in conflict cu credintele unui Afghan sau un Iranian de exemplu. Ca imigrant am devenit ceva mai receptiva la diferente, si la faptul ca democratia inseamna in primul rind acceptarea lor. Problema este ca vestul este inca refractar la diferente. Colonialismul fizic se continua cu unul spiritual, care nu vrea decit sa impuna fara a primi nimic in schimb. Daca vreti, Regina si soldatul a fost umilul meu protest contra politicii permanente de „The West and the rest”.
E.B.S:-În 2007 aţi publicat un docu-roman în urma sejurului de un an în China, pentru care aţi inventat o formulă scripturală extrem de ludică: întreţeserea unor texte de diferite tipuri (jurnal, poveste „tradiţională” chinezească, etc.). Eu consider această fabulă post-modernă drept o nouă treaptă în relaţia scriitoarei Felicia Mihali cu lumea (mai ales cu Orientul îndepărtat, ce pare a o atrage mai mult ca orice), dar şi primul roman în care se conturează tematica quebecheză, conştiinţa apartenenţei la spaţiul nord-american, devenit noul „acasă”. Cum vă percepeţi identitatea, la intersecţia atâtor culturi şi limbi?
F.M: – Formula de docu-roman mi-a fost ispirata de un regizor Innuit, Zacharias Kunuk, cel care isi numeste creatiile docu-filme, un amestec de documentar si de fictiune. Sweet, sweet China, plecind de la titlul in engleza, este un astfel de hibrid, unde se amesteca memorialistica, informatia documentara, si o parte fictionala. Partea ludica este sustinuta de inserarea unor colaje, realizate cu umor si inspiratie de artista Mirela Ivanciu, pe care am cunoscut-o la Beijing si ale carei cunostinte din domeniul artei mi-a facut sederea extrem de placut. Anul petrecut la Beijing, un loc departat in egala masura si de Romania si de Canada, a fost locul unde mi-am reconsiderat dubla identitate. Daca la un moment dat am inceput sa pierd cite ceva din cea romaneasca, la Beijing a inceput cu adevarat sa se contureze cea franco-canadiana. Pe de alta parte, contrar a ceea ce mi se spune uneori, China a fost locul unde fascinatia mea pentru Orient a devenit un sentiment lucid, golit de false mituri. In inima Orientului am descoperit valorile vestului pe care le cultiv si le apreciez. Evident ca uneori ma inversunez impotriva acestor valori pe care le critic si le ironizez fara insa a le nega in intregime. Daca exista un loc unde individul se poate realiza prin el insusi, si se poate elibera de cusca traditiei, acesta este Ocidentul. Sweet, sweet China este in primul rind o dovada a ambivalentei Est-Vest. Din punct de vedere naratif este experimentul cel mai indraznet, si poate imposibil de egalat de mine insami. Personal o consider cartea mea cea mai complexa.
E.B.S: – Aţi scris o mare parte din ultimele cărţi în perioade mai calme, de burse sau sejururi literare acordate de către Conseil des arts et des lettres du Québec. Cum funcţionează în Canada acest sistem de susţinere a artiştilor şi care sunt avantajele?
F.M.- Sper ca regimul conservator al lui Stephen Harper sa isi dea seama la timp de aberatia facuta, aceea de a taia din subventiile acordate artistilor. Pentru multi creatori, din toate domeniile, bursele oferite de consiliile de creatie sint uneori singurele surse de venit. Ori, de cind exista aceste organisme, la nivel provincial si federal, este evidenta efervescenta vietii culturale canadiene. Raportat la o populatie care depaseste cu putin pe cea a Romaniei, este uimitoare cantitatea de scriitori, de muzicieni, de cineasti, de dansatori, de regizori. Iar in Quebec, cu cei 7 milioane de locuitori, proportia este si mai evidenta. Nici un artist nu se imbogateste de pe urma burselor, dar pentru cei mai multi asigura o perenitate a creatiei. Metoda de a le obtine este simpla. Anual se depune un dosar continind un proiect de creatie, un dosar de presa care sa sprijine realizarile anterioare, si asta e tot. Pentru scriitori, bursele pot fi de la 15.000 la 25.000 $ cad, o suma care are menirea de a-ti asigura subzistenta un an de zile, timp folosit pentru a realiza proiectul. Orice stat care se respecta are obligatia sa sustina creatorii. Fondurile alocate acestor consilii sint cea mai buna investitie a unui guvern, pentru ca se investeste in cultura, care reprezinta viitorul unei tari. Nu indraznesc sa sugerez asa ceva in Romania, dar artistii romani ar merita din plin un astfel de program, mai ales tinerii. Iar guvernantii ar trebui sa fie constienti ca raportate la buget, astfel de sume sint derizorii. Personal, de cind sint aici am si fost membra a juriilor de acordare a acestor burse si in fiecare an am beneficiat de una, asa ca pot depune marturie ca totul se face cu buna credinta si fara favoritisme.
E.B.S: – Dina (2008) şi Confession pour un ordinateur (2009) mizează mult pe faţetele identităţii feminine şi, în contextul acestui va-et-vient între spaţiul de origine şi cel de adopţie, pe sentimentul exilului, pe o anumită viziune lucidă a statutului de entre-deux. Dina aduce în discuţie, la fel ca şi Confession (dar în mult mai mică măsură) condiţia femeii sub dictatură – politică sau masculină, relaţiile dintre femeie şi bărbat fiind văzute ca un raport de forţe – eliberarea prin erotism, de multe ori acesta fiind ultimul colac de salvare. Este statutul femeii supus schimbării în lumea în care trăim sau, dincolo de învelişul de multeori înşelător, aceleaşi tipare arhaice se regăsesc în noua identitate feminină?
F.M. –Raspunsul la aceasta intrebare depinde foarte mult de punctul geografic in care te afli. Cred ca in Occident, femeia si-a cucerit multe drepturi, in ciuda ironiei permanente la care este supus feminismul. Cu toti stim ca este o miscare care are bunele si relele sale, si ca numeroase derapaje s-au produs in graba de a accelera schimbarile unei mentalitati paternaliste si falocrate. In Iran, Arabia saudita sau Afganistan evident ca toate aceste discutii sint caraghioase. Despre ce cistiguri poti vorbi cind o femeie nu are dreptul sa iasa din casa nemascata si neinsotita? Cele doua romane vorbesc de fapt de rolul pe care istoria si traditia il joaca in destinul femeilor, mai precis in lipsa de alegere in ceea ce priveste optiunile. Iar partea proasta este ca uneori cei mai vajnici gardieni ai traditiei nu sint barbatii ci femeile ele insele. Cenzura, frica, complexele de tot felul au transformat-o inr-un jandarm a ceea e bine si ce e rau pentru consoartele sale, si asta de multe ori doar pentru a face placere barbatului, sau a-i dovedi bunele sale moravuri. Probabil ca dictaturile religioase si obscurnatismul vor disparea cind femeile vor refuza sa colaboreze. Dina este victima unui regim care ii taie orice aspiratie si posibilitate de eliberare. Iar Confession este istoria unei femei a carei incercare de eliberare cade in grotesc, tocmai pentru ca societatea romaneasca nu ofera nici sprijin si nici incredere unei femei singure.
E.B.S: – Ştiu că răspunsurile la aceste întrebări îmi vor parveni din noua Dvs. „aventură” culturală, de data asta în teritoriul Innu, unde predaţi limba franceză timp de un an, în sânul unei comunităţi care se numără printre acele „prime naţiuni” ale Americii de nord. Este această experienţă un punct de plecare pentru o nouă carte?
F.M:- Deocamdata venirea mea la Schefferville a fost stimulata de dorinta de a cunoaste Marele Nord, o dimensiune indispensabila a identitatii canadiene. Daca va si iesi o carte de aici nu stiu inca. Deocamdata profit de iesirile la vinatoare de caribu si de raidurile in tundra in compania prieteniilor Innu. Dar mare parte din timp mi-o petrec la scoala, incercind sa adaptez programul scolar oficial la un grup uman care pina acum 30 de ani era inca nomad. Nimic din ce functiona in scolile din Montreal nu se aplica in Marele Nord, unde copiii cred ca e mai important sa insotesti familia la vinatoare in padure decit sa vii la scoala. Schefferville a fost un oras minier, fondat pe locul comunitatii Innu Matimekush in 1950 si inchis in 1980. Dupa plecarea celor 4000 de albi, au mai ramas pe loc in jur de 600 de autohtoni, numai ca sistemul lor de viata traditional a fost ruinat de trecerea camioanelor cu minereu. Dezvoltarea economica o nordului imbogateste citeva companii si o mina de albi, iar in urma lor ramine dezastrul ecologic, alcolul si drogurile pentru autohtoni. Nu e de mirare ca elevii ne asociaza pe noi profesorii cu sefii companiilor miniere, si ne exprima direct antipatia. Ramine sa le dovedim ca avem alte intentii. Asa ca pur si simplu nu am timp sa ma gindesc la carti.
EB.S.: – Care sunt, în acest moment, proiectele literare aflate în faza de „şantier avansat” şi pe când noi apariţii pe piaţa de carte canadiană? Dar în România?
F.M.:-In acest moment am terminat un roman care se numeste L’enlèvement de Sabina (Rapirea Sabinei), o rescriere moderna a mitului Sabinelor combinat cu cel al Danaidelor. Ideea acestei carti este cea de care v-am vorbit deja, aceea ca orice tiranie exista si dureaza cu sprijinul femeilor. In momentul in care femeile vor refuza sa fie unealta unor sisteme represive, multe lucruri se vor schimba. In cultura occidentala, incepind de la Renastere, Sabinele sint vazute ca continuatoare a traditiei, gardiene ale caminului, utind ca ele au fost vicitimele unui viol colectiv. Se pare ca imaginatia masculina care a clocit acest mit n-a incercat niciodata sa imagineze ce poate simti o femeie rapita din sinul familiei si obligata sa traiasca linga un barbat care o poseda cu forta. Despre cind si cum Romania va publica ce scriu eu este o perspectiva mult ingreunata in prezent de criza prin care trece toata lumea. Ca peste tot in lume, editorii romani vor sa faca bani, iar in acest moment se pare ca Felicia Mihali nu este un produs prea ademenitor.
E.B.S: -Mulţumesc, Felicia Mihali, fie ca „vara indiană”, ba chiar şi iarna canadiană ce urmează să vă aducă inspiraţie şi creativitate!
F.M.: – Eu va multumesc.
De Elena-Brânduşa Steiciuc, TIMPUL, noiembrie, 2010