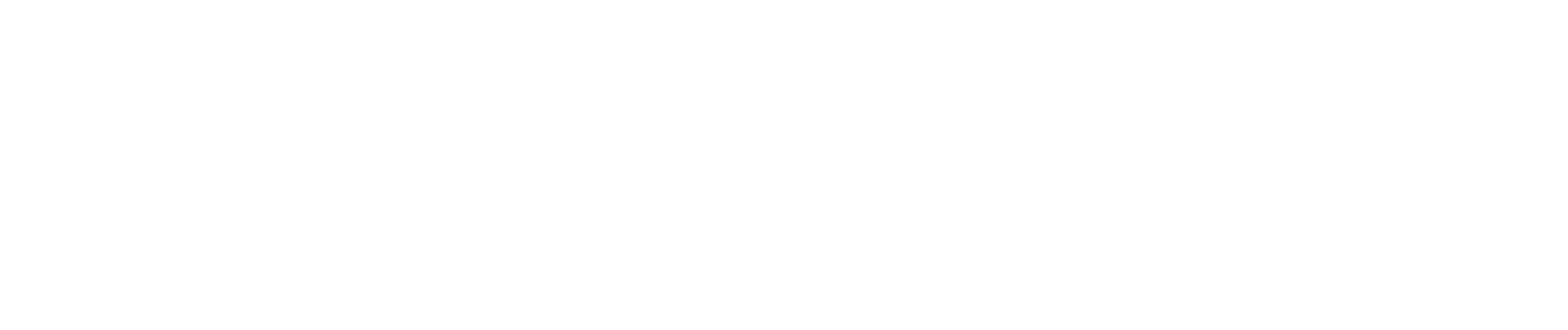Licentiata in filologie, in limbile chineza si olandeza, ii simteai de la prima intalnire eruditia si te nelamurea statutul ei de « doar » ziarista la « Evenimentul zilei ». Pentru ca asta era Felicia Mihali pana in anul 2000. Dar in acel an, de fapt, in doar cateva luni, totul s-a schimbat. Focul care mocnea a izbucnit in trei carti deodata, toate de mare succes: « Tara branzei », « Mica istorie », « Eu, Luca si chinezul ». N-a stat insa sa-si deguste celebritatea, ca si-a facut bagajul, si-a luat barbatul, copilul si lucrurile cele mai dragi (camasile de borangic ale bunicii sale si cateva tablouri) si a trecut Oceanul. Definitiv. De ce? De spaima. Din teama terifianta ca la batranete va fi saraca si uitata, asa cum se intampla cu toti artistii in Romania. Dupa doar doi ani de existenta canadiana, primul ei roman, « Tara branzei », tradus in franceza, facea mare succes. Intre masteratul sustinut la Universitatea din MontrEal in domeniul literaturilor comparate, studiile de istorie a artei, participarile la diverse conferinte si intalnirile cu cititorii sai, Felicia Mihali isi tese, cu migala, talent si constiinciozitate, un statut special de scriitoare si om de cultura, pentru care publicul sau o admira, o rasfata si ii cumpara cartile. Nu, hotarat lucru: Felicia Mihali nu este dintre cei pentru care sperantele puse in emigrare s-au transformat intr-un lung sir de tanguiri si carteli.
Canada a fost o alegere foarte buna pentru mine
– Dupa doar trei ani de la emigrare, iata-te acasa, in Romania, in postura de reprezentanta a scriitorilor de limba franceza din Canada…
– Am venit sa prezint in cadrul unui seminar organizat de Ambasada Canadei din Romania opera unui cunoscut scriitor canadian, Rejean Ducharme. Si, bineinteles, sa confirm scepticilor de aici debutul meu ca scriitoare dincolo de Ocean. Canada a fost o alegere foarte buna pentru mine, iar scriitoarele-emigrante sunt, intr-adevar, o forta acolo. Au carti foarte bune, sunt foarte respectate si foarte iubite. Exista autoare ca May Telmissany, care-mi este prietena, Alina Apostolska, Yin Chen, Catherinne Mavrikakis, care sunt foarte puternice, foarte prezente in viata culturala canadiana. Exista o voga, o moda a femeilor care vin din alte spatii culturale si care aduc noutate in literatura, prospetime, si ca stil, dar si ca subiect.
– Este publicul canadian mare consumator de literatura sau scriitorii-emigranti sunt cititi doar in comunitatile lor?
– Sansa unui scriitor este sa iasa din comunitatea lui. Romanii de acolo imi reproseaza ca nu mai scriu romaneste. Dar acesta a fost primul lucru pe care am fost nevoita sa-l fac, alegand emigrarea: sa renunt la scrierea in limba romana. Cand vrei sa devii cunoscut intr-o tara straina si sa te impui ca scriitor, normal ca nu mai poti scrie in limba materna. In cazul meu, traind in Canada franceza, eu citesc in franceza, vad filme titrate in franceza, vorbesc in franceza, ar fi o sinucidere curata sa scriu in romana cand, de fapt, eu traiesc in franceza. Pe urma, care editura din MontrEal ar edita cartea in romaneste, care librar ar primi-o in rafturile arhipline de opere in franceza si engleza? Nu voi scrie in romaneste, dar publicul privilegiat este si va ramane cel roman. Spun asta ca o declaratie de credinta.
– Inteleg ca prima initiativa peste Ocean a fost sa-ti traduci cartile. Cum au fost primite de canadieni?
– Cartea mea, « Tara branzei », a placut foarte mult, iar eu am fost comparata cu o clasica a literaturii lor, Marie Claire Blais, foarte cunoscuta in spatiul cultural francez. Cel mai tare m-am temut atunci cand cartea a aparut pe piata canadiana, ca cititorii se vor opri la primul nivel al cartii: la imaginea satului, la comunism, la saracie, lucru care nu s-a intamplat. Cronicile publicate in ziarele din QuEbec, « Le Devoir » si « Le Soleil », fac dovada faptului ca romanul a fost citit cu un ochi detasat. In orice caz, receptia cartii aici este peste asteptarile mele. Asa cum mi-am dorit, publicul de aici sondeaza profunzimile cartii, nu structura ei de suprafata. In ceea ce priveste povestea de dragoste din roman, nu va spun ce reactii am avut din partea compatriotilor mei de aici. Unul m-a numit « profesoara de sex », altul m-a facut « obsedata sexual », cand totul in carte este atat de voalat, atat de discret si de putin spus.
– Sa inteleg ca romanii din QuEbec te accepta mai greu decat canadienii?
– Un lucru e sigur: daca m-a lansat cineva ca scriitoare acolo a fost QuEbecul, in nici un caz comunitatea romana. Pentru mine, comunitatea inseamna in primul rand cei cativa prieteni care m-au sprijinit de la inceput si au crezut in mine, inseamna presa romaneasca de aici, care a scris despre mine in termeni extrem de elogiosi, postul de radio, ca si cel de televiziune. Restul, pana la 30.000, cat se spune ca numara comunitatea noastra, ma trateaza cu o indiferenta care ma doare. Din cele 20 de exemplare ale cartii mele care existau in magazinele romanesti, in primele doua luni de la aparitie nu se vanduse nici unul. Am gasit de cuviinta sa ma pastrez putin la distanta, sa primesc cu foarte mare retinere atat laudele, cat si criticile sau observatiile. De cateva luni, lucrez si eu la postul de televiziune romanesc, unde fac agenda culturala romaneasca, dar incerc sa fac mai mult de-atat, sa-i indemn pe romani sa consume mai multa cultura locala.
Norocul meu a fost ca am gasit oameni care m-au sfatuit de bine
– Ai vorbit despre prieteni. E greu sa-ti faci prieteni acolo, departe, in exil?
– E greu sa-ti faci prietenii de care ai nevoie, pentru ca prieteni iti faci la tot pasul si ajungi sa te aduni cu oameni cu care nu ai nimic in comun si cu care in Romania nu as fi stat niciodata impreuna, din considerente de timp. Norocul meu a fost ca am gasit aici oamenii care m-au sfatuit de bine, in sensul in care-mi trebuia mie. Adica, in primul rand, sa accept sa traiesc modest de la inceput si sa ma concentrez asupra lucrului la carti si asupra studiilor. Cand am plecat din tara, am renuntat la orice in bagaj, ca sa-mi iau tablouri (Salisteanu, Ilfoveanu, Caltia, Gherasim, Chitac), litografii, icoane. Desenele lui Ilfoveanu, care sunt superbe, nu le-as lasa nici moarta. Pe toate le-am desramat, le-am dus la Patrimoniu, mi le-au numarat bucata cu bucata, mi-au facut actele de trecere a granitei pentru ele si acum dau stralucire locuintei mele modeste. Fara ele in casa, cred ca iernile din Canada ar fi mai greu de suportat. Le-am facut niste rame mai umile, dar stau bine acolo unde sunt. Camasile bunicii din borangic nu le mai port, mi-e frica pentru ele, au inceput sa se destrame, le arat doar celor care ma viziteaza. La un moment dat, aveam trei traducatoare ale romanului, doua pe franceza, una pe engleza, pe care, din cand in cand, le invitam la mine acasa, sa le fac mancare romaneasca (ciorbe, tocanite), sa le arat zestrea mea si sa le povestesc de Romania. Cand merg la cineva in vizita, intotdeauna imi place sa duc fie o caseta cu muzica romaneasca (le « compilez » eu un Grigore Lese, Domnica Trop cu taraful din Clejani, fanfara din Zece Prajini), fie mici vase de ceramica traditionala, iar canadienii sunt atat de fericiti sa primeasca ceva din alt spatiu cultural decat al lor…
Spuneam ca am fost nevoita sa merg la facultate, sa-mi refac studiile – acolo, daca nu ai studii, niciodata n-o sa poti sa ai sperante la o slujba buna. Am facut la Universitatea din MontrEal cursuri de literatura comparata si m-am specializat intr-un domeniu total diferit de ceea ce facusem in Romania, si anume, in studii postcoloniale, care este cel mai nou, cel mai in voga domeniu din literatura, mai ales in facultatile americane (francezii nu vor sa auda de asta, ca si cand ei n-ar avea treaba cu coloniile). Apoi, am urmat cursuri de istoria artei, asta a fost pasiunea mea, fara a avea neaparat dorinta sa fac o meserie din asta, ci pur si simplu pentru ca mi-a facut placere si mi-a prins foarte bine, a fost ca vacanta mea intelectuala, desi am invatat foarte mult. Am fost si eu, si sotul meu, bursieri, am avut fiecare cate o mie de dolari pe luna, cu care am trait absolut onorabil. Iar fata mea este acum la o scoala particulara, care ma costa 500 de dolari canadieni pe luna. Socotesc ca merita sacrificiul, pentru ca, din pacate, invatamantul de stat este foarte slab la ei. Ea s-a integrat colectivului clasei, e chiar foarte buna la invatatura. Deci, noi am putut trai decent pana acum, doar din bursele noastre de studenti. Care-i tara care-ti ofera sansa asta? Cei care nu apreciaza acest lucru o fac din rea vointa.
Radacinile mele sunt in aer
– Ce ai acum in lucru pe masa ta de scriitoare?
– Toata aceasta vacanta de trei ani pe care am avut-o din punct de vedere al scriitorului este chiar ceea ce aveam nevoie ca sa scap de o anumita formula literara. Sunt foarte curioasa ce voi descoperi de acum inainte. Am terminat « Regina si soldatul », un roman inspirat de viata lui Alexandru Macedon, in special viata lui amoroasa, foarte controversata de istorici. Actiunea se petrece la 330 i. Hr., in timpul campaniilor lui Alexandru Macedon in Orient, cand l-a omorat pe Darius la Issos si toata familia acestuia a devenit prizoniera lui, respectiv mama si sotia marelui rege persan. Le-a purtat doi ani cu el in campanie, si tanarul de 23 de ani care era Alexandru Macedon a fost atat de fascinat de personalitatea batranei persane, mama lui Darius, incat se spune ca a avut o relatie intima cu ea. Ea avea intre 65 si 70 de ani. Pana la urma, mama regelui Darius vine sa traiasca in Grecia, in timp ce Alexandru isi face campania pana la Indus. Adevarul istoric este ca atunci cand ea a aflat ca Alexandru a murit, s-a lasat sa moara prin infometare. Dar povestea mea nu se termina asa. M-am documentat enorm pentru acest roman, dar mi-a facut o mare placere, pentru ca imi plac cronicile vechi, in care gasesti amestecul acesta de adevar si fictiune. Ce sa spun? In momentul de fata traiesc cu picioarele in doua lumi diferite, radacinile mele sunt in aer acum, intre cele doua spatii. Unii socotesc ca asta este o identitate incompleta, ei spun ca imigrantul e cineva care a pierdut o tara, fara sa regaseasca alta. Exista o viziune negativa asupra imigrantului, intotdeauna exilul este calculat in termeni de dezavantaj. Eu cred ca este un avantaj sa ai o dubla identitate, fiecare dintre ele venind cu incarcatura ei sociala, culturala, politica, de civilizatie, de traditie, de cutume. De aceea, eu calculez exilul in termeni de avantaj, il socotesc un mare castig.
– Pentru unii, aceasta dubla identitate este o povara si o sursa de depresii, de dezamagiri, cel putin asa razbate din scrisorile primite la redactie din partea multor imigranti. Ce i-ai sfatui pe cei care aleg drumul ingust al parasirii tarii?
– In primul rand, sa-si motiveze foarte bine plecarea, pentru ca mobilul este foarte important. Sunt multi care nu stiu nimic despre tara de primire, isi inchipuie ca aici este Paradisul. Este, intr-adevar, Canada un mic paradis social, tara in care poti sa nu muncesti si nu mori de foame, dar, daca pleci cu aceasta idee, ca acolo nu trebuie sa muncesti si vei trai bine, ca vei acumula nu stiu ce averi, ti se vor spulbera in mod dramatic toate visurile. Poti sa fii bogat si sa fii foarte nefericit, si sa fii sarac dar fericit, iar romanii au niste radacini ceva mai puternice decat alte natii, poate este natura noastra, de popor rural, agrar, static. Ii vad pe emigrantii romani ca vin cu covoare, cu tablouri, bibelouri, macrameuri etc. Si eu am facut la fel, dar cand am ajuns aici, nu m-am izolat in casa, intre lucrurile aduse de acasa. Mie mi-a placut orasul de la inceput, mi-a placut Montrealul, m-am implicat in viata culturala, am continuat sa merg la teatru, la film, vara e plin de festivaluri de jazz, de film, e o frumusete, sunt foarte multe gratuitati, pentru ca e adevarat ca arta e scumpa. Romanii din comunitate nu fac asta, se ghetoizeaza, se lamenteaza, nu mai ies din casa, nu fac decat sa munceasca ca sa acumuleze rapid o stare materiala bunicica, fac o obsesie din asta, iar daca cumva raman fara slujbe, intra in niste depresii cumplite. Si nu folosesc sansa pe care o au: exista atata deschidere culturala acolo, incat trebuie sa fii orb sa nu vezi, sa nu o simti. Acolo ai acces, prin cultura, la lumea larga, dar ei nici nu-si dau seama de asta. Se intalnesc doar sa manance si sa povesteasca ce bine era in Romania. Au psihologia regretului, a nostalgiei, a negativismului. Cand ti se ofera atatea facilitati, si financiare, si sociale, trebuie doar sa deschizi ochii, sa vezi putin ce e in jurul tau. Sa te plimbi prin MontrEal, ca e un oras frumos, curat, degajat, imprejurimile sunt superbe, sunt statiuni foarte frumoase, prin care noi, eu cu sotul si cu fiica mea, facem lungi plimbari cu bicicletele. Vara e cald si umed in MontrEal, iarna e foarte geroasa, ianuarie, februarie sunt cumplite, trecerile acestea dintre anotimpuri le suport greu, dar in momentul acesta nu tanjesc dupa nimic din Romania. Singurul lucru la care aspir este sa ajung cu cartile mele la acea perfectiune pe care o doresc. Cea mai mare bucurie a mea este sa stiu ca cineva imi citeste cartea si are o reala placere din asta. In rest, sunt foarte multumita, am prietenii pe care-i vreau, locuiesc intr-o casa unde pot fi fericita, chiar daca e modesta, prost impartita, e galagie, dar nu conteaza asta, nu traiesti din asta, nu fac o obsesie din asta. Nu fac parada de o fericire de prost-gust, dar sunt multumita de ceea ce fac acum.
– Cum te vezi peste zece ani, draga noastra pierduta scriitoare?
– Sergio Kokis, un scriitor foarte in voga acum in Canada, foarte prizat de public (ucrainean la origine), mi-a spus intr-o zi: « Daca ai rabdare sa stai zece ani in QuEbec, vei fi marea lor scriitoare ».
Corina Pavel, Formula As Anul 2003 Numarul 600, Scriitori din diaspora