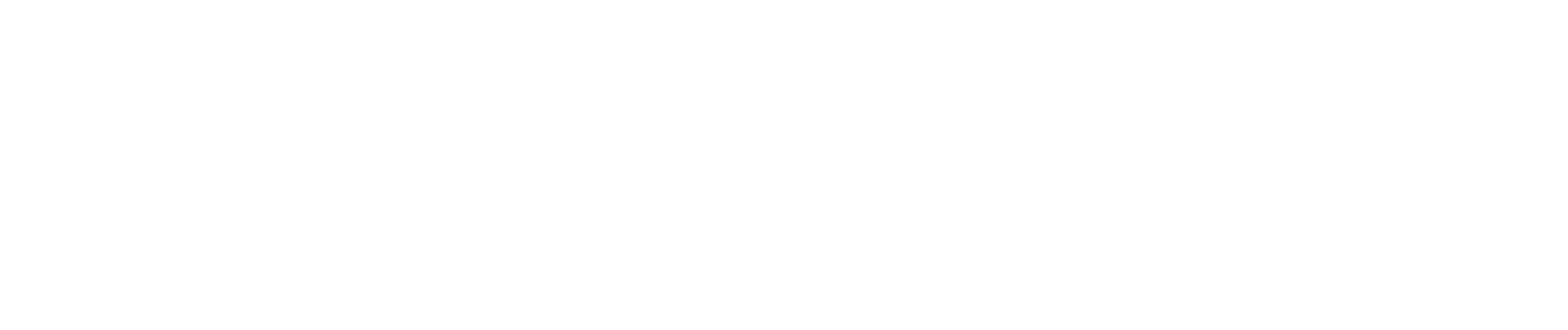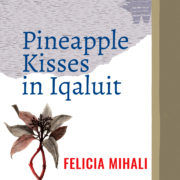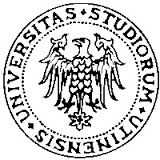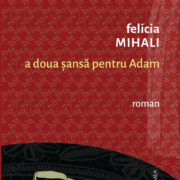LE DEVOIR – UNE ROBINSONNE DE PREMIÈRE FORCE
On a envie de remercier Felicia Mihali d’avoir eu l’idée de s’installer ici il y a deux ans après avoir quitté sa Roumanie natale: elle nous offre, comme cadeau inespéré, ce premier roman qui révèle déjà un talent d’écrivain.
La ressemblance suggérée, sur la quatrième de couverture, entre ce livre et le chef d’œuvre de Marie-Claire Blais, Une saison dans la vie d’Emmanuel, n’est pas qu’un simple fanfaronnade d’éditeur comme on en lit souvent. Il y a dans Le pays du fromage une puissance d’évocation assez semblable, une même faculté d’insuffler une sombre beauté à un monde de déchéance.
Le lieu même où se passe l’essentiel du roman de Mihali n’est pas sans rappeler celui de Blais : un hameau perdu quelque part dans une lointaine campagne, un de ces coins de misère comme il y en a dans la plupart des pays du monde, là où la vie semble arrêtée depuis des siècles. C’est dans cette Roumanie profonde, où on pourra reconnaître tout à la fois un arrière-pays universel, que la narratrice du roman de Mihali a grandi et qu’elle décide de revenir, en emmenant avec elle son jeune fils, après 15 ans passés dans la capitale. Elle quitte du coup son mari, dont elle vient de découvrir qu’il a trompait.
Dépit ou simple coup de tête? Au moment de partir, elle a en tout cas le sentiment que l’aventure l’attend alors qu’elle un jette un dernier coup d’œil sur les étagères de sa bibliothèque, où elle remarque le Robinson Crusoé de Defoe de même que l’étonnante réécriture qu’en faite Michel Tournier dans Vendredi ou les limbes du Pacifique. On devine qu’il s’agit là d’un clin d’œil narquois à la littérature la narratrice a fait des études en lettres sans pouvoir en vivre – elle n’a jamais travaillé que comme secrétaire dans une entreprise d’import-export – s’essayerait-elle à « la » vivre?
Sans nostalgie apparente, elle s’installe dans une des masures abandonnées où elle a grandi. Paradoxalement, el semble régner dans ce logis insalubre, comme dans tout le village, un génie des lieux, insidieux, maléfique, auquel elle s’abandonne à son tour. Au fil des jours et des semaines, pendant les quelques 28 mois qu’elle va passer là-bas, elle vivra dans la crasse et le désordre, parmi la vermine, se nourrissant à peine, dans un état de prostration entrecoupé de brefs sursauts d’énergie. Son fils, laissé à lui-même, devient peu à peu un enfant sauvage, plus à l’aise avec les bêtes qu’en compagnie des humaines.
Ce choix délibéré de la jeune femme d’une existence quasi primitive ne semble pas révéler d’une quelconque volonté d’ascétisme – ses accès de sensualité débridée ont tôt fait de nous détromper là-dessus. Il s’agirait plutôt d’un passage obligé qui lui permettrait de découvrir, à sa propre surprise, ses racines paysannes, comme s’il lui fallait pour cela connaître un dénouement qu’elle n’avait même pas connu dans son enfance, une déchéance qui remonte bien au-delà de son propre passé.
Elle s’adonne donc à une imprégnation totale dans ce lieu, qui la sollicite corps et âme. Tous ses sens sont envahis, en particulier l’odorat qu’elle a très sensible. L’expérience est éprouvante dans ce pays de fromage, comme elle dit, dont les effluves l’ont toujours écœurée. Elle revivra par ailleurs l’antique soumission des femmes en fréquentant un ami d’enfance, un homme « assez vieux pour que son instinct paternel soit atténué par l’égoïsme de vivre librement », dont elle aime l’indifférence, pour qui les femmes sont des simples objets de plaisir toutes interchangeables. Elle lui est reconnaissante de montrer par là « son immense honnêteté masculine »…
Parmi les souvenirs qui lui reviennent, elle s’attarde à celui de quelques proches, moins ses père et mère qu’une tante, qui fut une conteuse hors pair. Elle donnera d’ailleurs à la narratrice le goût de récréer en imagination une partie du passé familial, en particulière celui d’un couple de bisaïeuls.
L’imaginaire prend ainsi le relais du corps et de ses sensations pour lui permettre d’habiter toute entière le lieu de son enfance. Il y a jusqu’à sa perception des autres qu’elle tente de calquer sur celle de ces campagnards frustes, aussi durs que leur coin de pays. Autrefois comme aujourd’hui, assure-t-elle, tout n’est « que peine et accouplement. Homme et femmes : entre eux il n’y a de place ni pour la beauté, ni pour la tendresse, ni pour l’amitié ».
La littérature, dans cette aventure, lui sera longtemps de peu de secours. On croirait même qu’elle l’a reniée. Mais la voici qui lui revient alors qu’un ami bienveillant lui offre une partie de sa bibliothèque. Elle va lire ou relire des auteurs de toutes les pays, de Shakespeare à Samuel Beckett en passant par Diderot ou Novalis, mais ce sera pour ne retenir chez l’un ou l’autre qu¢une phrase ou le trait de caractère d’un personnage.
Ce roman de Felicia Mihali est une des très belles surprises de ce printemps. Elle l’a, dit-on, écrit dans sa langue maternelle, puis traduit elle-même. On peut parler ici d’une version originale, dont l’écriture est plutôt sobre, fort bien maîtrisée. Mihali savait bien que ce que raconte ce personnage de femme est parfois assez terrible : ce n’était pas la peine d¢en ajouter sur la manière de le dire.
Robert Chartrand (LE DEVOIR, Montreal, 5 Mai 2002)