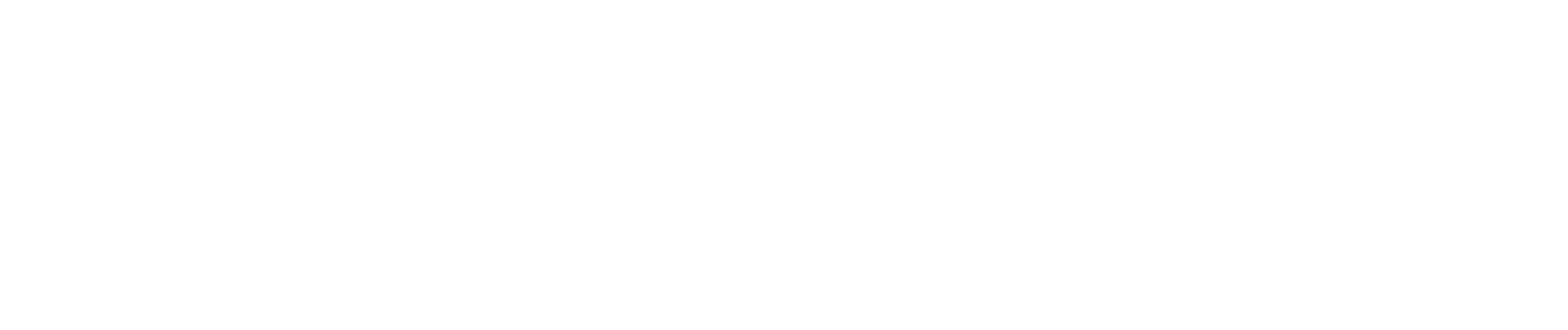« La bien-aimée de Kandahar » : raccourcir le temps et les distances
En 2007, un sergent canadien en mission en Afghanistan a écrit à l’équipe du magazine Maclean’s pour la remercier d’avoir publié la photo d’une jeune femme en page couverture. Adulée par tout un bataillon de soldats à Kandahar, la nouvelle cover-girl donnait du moral aux troupes. Le magazine MacLean’s a vite saisi l’occasion d’en faire un article sur celle qu’ils ont nommée « La bien-aimée de Kandahar ». Cela a aussi inspiré un roman du même titre à une auteure montréalaise d’origine roumaine, Felicia Mihali, connue, entre autres, pour son roman Le pays du fromage.
L’auteure a publié sept livres en français et deux en anglais. La bien-aimée de Kandahar est une réécriture de The Darling of Kandahar paru en 2012. Dans son roman, l’histoire de Paul Chomedey de Maisonneuve et de Jeanne Mance fait écho à la correspondance d’un militaire canadien et d’une cover-girl venue du « pays de Dracula » et habitant à Montréal. Derrière ces personnages historiques ou médiatiques se cache une humanité fragile et tourmentée. Felicia Mihali nous rappelle avec éloquence que les mythes sont davantage le reflet d’un espoir collectif que celui de la réalité. Outre ces histoires extraordinaires, le roman raconte également la vie d’une immigrante à Montréal, sa cohabitation avec sa mère, ses études, ses amours. Entretien avec Felicia Mihali.
En quoi l’histoire du magazine Maclean’s, publiée en 2007, t’a-t-elle inspiré l’écriture d’un roman?
J’ai lu cette histoire au cours de l’année 2007, lorsque la guerre en Afghanistan battait son plein. Le monde était encore enthousiaste et confiant dans le rôle bénéfique des forces armées étrangères en ce qui concerne l’annihilation des talibans et la libération de la population afghane de l’un des régimes les plus oppressifs qui soient. Un an plus tard, le Canada, comme le reste du monde, avait commencé à comprendre qu’aucune armée ne pourrait jamais exporter la démocratie, une sorte de plante fragile qui doit pousser dans la terre locale et non pas dans un port d’exportation.
Personnellement, je suivais chaque semaine le compte rendu des exploits de l’armée canadienne qui était encore soutenue à l’époque par la population, surtout dans le Canada anglais. Et c’est comme cela que je suis tombée sur la rencontre un peu fortuite entre un mannequin d’origine roumaine, Kinga Ilies, vivant à Toronto, et un soldat canadien, Chris Karigiannis, posté à Kandahar. Mais ce qui m’avait particulièrement troublée était le fait que trois semaines après leur rencontre virtuelle à travers les médias, le soldat mourait dans une explosion à la bombe. C’était une cruelle coïncidence que parmi les 40 soldats morts en Afghanistan, une des victimes soit le héros de cette possible histoire d’amour.
Mais ce qui m’avait déterminée vraiment à essayer d’immortaliser leur histoire, c’était le fait que le soldat soit un Lavallois, mon concitoyen si vous voulez, et que son corps soit enterré dans un cimetière de Sainte-Rose, non loin de chez moi. Je suis allée à l’enterrement par curiosité et pour vérifier aussi si la belle Kinga était là. Non, elle n’y était pas, et j’en étais déçue.
Dans La bien-aimée de Kandahar, il est aussi beaucoup question de la fondation de Montréal au 17e siècle. Qu’est-ce qui t’a amenée à superposer l’histoire de Jeanne Mance et de Maisonneuve à celle d’un hypothétique amour entre Irina, une étudiante montréalaise devenue cover-girl, et Yannis, un militaire canadien parti combattre en Afghanistan?
J’enseigne l’histoire au secondaire et j’ai toujours été fascinée par la fondation de Montréal, qui fut à l’origine une mission religieuse sans but commercial, à une époque où la Nouvelle-France n’était qu’un poste de traite pour la métropole française. L’explication est que la mission montréalaise des 40 hommes et femmes catholiques fuyant une Europe ravagée par les guerres religieuses était une mission humanitaire aussi, qui impliquait le travail des femmes comme Jeanne Mance et Marguerite Bourgeois, une infirmière et une sœur.
À partir de cet exemple, j’ai compris en partie pourquoi la mission canadienne en Afghanistan ne pouvait pas réussir. Cette guerre était portée par des hommes armés sans inclure le travail humanitaire, social, culturel qui est souvent le lot des femmes. Le rapport entre Yannis et Irina ressemble un peu à celui de Paul et de Jeanne, qui fut une amitié chargée d’affection, de dévouement. Il est intéressant de voir que Chris meurt en terre étrangère alors que sa mission est vouée à l’échec, tandis que Maisonneuve a réussi sa mission avec Jeanne Mance à ses côtés.
Selon toi, qu’est-ce que Yanis et les soldats de sa garnison ont vu dans la photo d’Irina qu’ils n’ont pas pu voir dans celles des autres mannequins?
L’amour reste une alchimie complexe qui refuse de se laisser analyser en laboratoire. Dans le livre, comme dans la vraie histoire du magazine Maclean’s, je suppose que c’est ce type de réaction simultanée entre mille particules secrètes qui se passe dans l’âme du soldat à la vue de cette femme. Le fait qu’elle est belle n’aurait pas suffi. Sur cette photo, elle garde une expression sereine, détachée presque de ce monde. Elle contemple plus qu’elle regarde devant elle. Je pense que c’est cette douceur qui manquait le plus aux soldats postés dans un endroit d’une violence extrême. Chris Karigiannis avait envoyé une lettre au magazine tout de suite, de façon impulsive, comme s’il savait ce qui l’attendait. Je pense que sa relation avec Inga (la vraie cover-girl), même aussi brève et virtuelle, a été la dernière grande belle aventure de sa vie.
Cette association entre Paul et Jeanne d’un côté et Irina et Yannis de l’autre ramène, entre autres, la question de la foi. Mais au lieu de les unir, elle ajoute encore plus de distance entre les deux personnages. Pourquoi?
En lisant les lettres du soldat, Irina se rend compte que Yannis manque complètement de ferveur chrétienne, ce qui, selon elle, doit être terrible quand on est à la guerre. Inutile de mentionner que depuis la nuit des temps, la foi a été le meilleur argument pour déterminer les gens à se laisser tuer. Yannis est un soldat d’un athéisme froid, d’où son drame. En tant que Grec, d’une part, et Roumaine d’origine, de l’autre, les deux appartiennent à l’Église orthodoxe, mais Irina avait été confrontée au catholicisme lors de son éducation à l’école Villa-Maria, un ancien monastère d’ursulines.
Sans être une fanatique, Irina a quelque chose d’une dévote, tout comme Jeanne Mance ; elle a une peur viscérale du péché, du conflit avec les parents ou les enseignants. Sa vie est réglée selon une hiérarchie presque ecclésiastique. Yannis, en revanche, est quelqu’un de complètement cérébral. Dans son monde teinté de sang, de violence et d’injustices, il n’y a pas de place pour un dieu, quel qu’il soit. Yannis meurt en quelque sort car il ne voit aucun but à sa mission, ni terrestre ni céleste. Après sa mort, Irina retourne encore une fois à la mission montréalaise, pour raconter la fin paisible de Paul et de Jeanne. Les deux avaient été unis par leur mission commune, mais aussi bien par la foi. Entre Irina et Yannis, ce lien qui transcende le monde physique est complètement absent. La conclusion du roman marque la déception d’Irina. Après l’enterrement de Yannis, elle dit qu’il n’y a pas de deuxième chance pour elle. Cette deuxième chance ne se réfère pas seulement à la rencontre d’un autre homme, mais de Dieu aussi.
La dualité entre les vocations d’explorateur et d’ermite est également présente dans ton roman. Qu’en penses-tu?
Je pense que le soldat répond bien à cette double définition. Il est un explorateur. Je crois que beaucoup d’hommes qui s’en vont à la guerre, au-delà de la solde généreuse, s’en vont poussés par leur obsession de découverte. Alexandre le Grand a conquis l’Asie sous plusieurs sortes de prétextes, mais je pense que la vraie raison était sa grande curiosité pour des terres inconnues. La plupart des recrues s’imaginent probablement que la guerre est une sorte de voyage à la solde du gouvernement.
Le nombre croissant de diagnostics de syndrome post-traumatique démontre combien grand est le contraste entre ce fantasme et la réalité. En même temps, Yannis est aussi un ermite. Les femmes en Afghanistan ne sont pour lui que des victimes. Même s’il connait bien les fantasmes des soldats de sa garnison, à mon avis, il n’y a aucun érotisme dans son regard. Même sa relation avec Irina se place sous le signe de l’ascétisme. Contrairement probablement à ce qu’un autre homme aurait fait, ses lettres sont complètement dépourvues d’allusions érotiques. Si Yannis n’est pas croyant, il rejoint la foi par sa grande pureté d’âme.
Alors qu’elle étudie à Montréal dans un groupe de maîtrise dont les membres sont issus de diverses nationalités, Irina remarque que même « si au premier abord, leur origine n’[a] pas d’importance, les alliances et les connivences se [forment assez vite] en fonction des pays et des anciens conflits. » Que signifie ce constat pour Irina?
Irina a grandi dans un contexte où son origine ne semblait pas avoir d’importance. Même si parfois les gens prononçaient mal son nom, cela n’était pas un argument pour se sentir discriminée. La relation avec Yannis, qui est Grec d’origine, réveille en elle une sensibilité dont elle n’était pas consciente. Cela nous montre en fait que, parfois, la discrimination dont les étrangers semblent être victimes vient d’eux-mêmes. Les immigrants amènent leur passé dans le nouveau pays.
Les Roumains et les Grecs ont eu une longue histoire commune à travers laquelle, apparemment, les dupes ont toujours été les premiers. Et jusqu’à la rencontre du soldat, cela n’avait aucune importance pour Irina. Sa correspondance avec Yannis, lui dévoile qu’elle reste en fait prisonnière des mêmes préjugés historiques que sa mère. Elle les déteste, même si les Grecs ne lui ont jamais rien fait à elle personnellement. Une société idéale serait donc celle où nous jugerions les autres selon nos propres expériences sans aucun préjugé historique.
Extraits :
« Vous ne vous tromperiez guère si vous me qualifiiez de banale, aussi banale que n’importe quelle personne sur cette planète, qui vit et meurt pour des desseins inconnus. Il n’y a aucun mérite à être né à tel ou tel endroit ni à mourir dans les lieux les plus inattendus, alors nos gaffes non plus ne devraient pas être jugées trop sévèrement, n’est-ce pas? » …
« Les talibans ne sont pour moi qu’une incarnation du pays, ce pays qui n’a jamais été une colonie, bien que l’Europe ait toujours été présente à sa frontière. Dans l’esprit des gens comme eux, les étrangers sont regardés comme des sots de génération en génération, car ils sont toujours rentrés chez eux la queue entre les jambes. Aujourd’hui, nous sommes ces sots vaincus par la montagne, par le froid, par le désert. »
Julien Fortin juillet 01, 2017, Les Méconnus