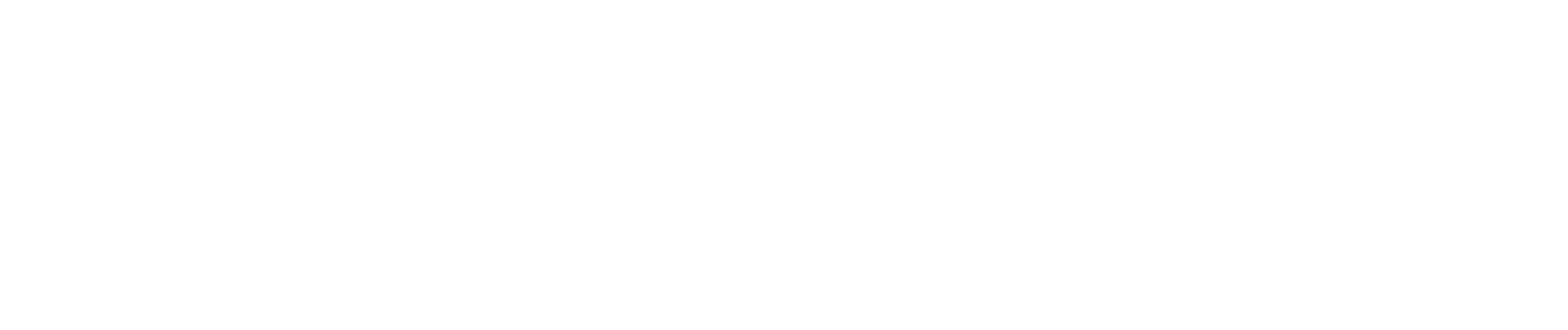Notice bio-bibliographique :
Née en Roumanie, le 20 août 1967, Felicia Mihali est diplômée en philologie (1995) et en études chinoises et néerlandaises (1997) à l’Université de Bucarest.
Pendant sept ans (1993-2000), elle a été chroniqueur de théâtre au quotidien bucarestois, «Evenimentul zilei» (L’Événement du jour), puis en 2000 elle a choisi de vivre au Québec. En 2001 elle a obtenu un Certificat en Histoire de l’Art à L’Université de Montréal. Deux ans plus tard, en 2003 la même université montréalaise lui a accordé le titre de Maître ès lettres, avec un mémoire portant sur la littérature postcoloniale.
En 2003 Felicia Mihali est partie en Chine où elle est restée un an pour travailler comme professeur de français. Recevant une bourse de création du Conseil des arts et des lettres du Québec en 2004 pour le projet du roman « La Reine et le Soldat », elle publie ce volume en 2005. Felicia Mihali est rédacteur en chef de la revue culturelle on line « Terra Nova Magazine » (www.terranovamagazine.ca)
Livres publiés en Roumanie :
« Tara brînzei », Bucarest, Ed. Image, 1998
« Mica istorie », Bucarest, Ed. Image, 1999
« Eu, Luca şi chinezul », Bucarest, Ed. Image, 2000
Livres publiés au Canada :
« Le Pays du fromage », Montréal, XYZ éditeur, 2002
« Luc, le Chinois et moi », Montréal, XYZ éditeur, 2004
« La reine et le soldat », Montréal, XYZ éditeur, 2005
Même si elle vit au Québec depuis sept ans seulement, Felicia Mihali s’est imposée dans « la belle province » par ses trois romans en français, qui lui réservent une place de choix parmi ceux qu’on appelle « écrivains migrants », comme Marco Micone, Sergio Kokis ou Abla Farhoud.
En fait, Felicia Mihali – que j’ai eu le plaisir de rencontrer au Congrès du C.I.E.F. organisé à Sinaia en 2006 – est beaucoup plus qu’une « migrante », car elle conserve les deux versants de son identité créatrice. C’est au sujet de ce rapport particulier entre ses écrits de la période roumaine et sa création en français que la jeune romancière montréalaise m’a fait l’amitié de réfléchir, pour ce numéro spécial de notre revue, autour de l’autotraduction.
Elena -Brandusa Steiciuc : -Lorsque vous avez décidé de quitter la Roumanie, Felicia Mihali, vous étiez déjà un jeune auteur à succès, surtout si nous pensons à « Tara brînzei », roman salué par la critique. Qu’est-ce qui vous a déterminée à traverser l’océan et à vous installer dans un nouveau pays, dans une nouvelle langue ? Saviez-vous à l’époque que cet événement de votre biographie allait déclencher la genèse de votre œuvre en français ?
Felicia Mihali : – Je le savais évidemment, car je l’avais prévu. La raison pour laquelle j’ai laissé derrière mon vécu en Roumanie a été mes livres. Je n’avais pas envisagé toutes les difficultés que le déménagement dans un pays parlant une autre langue impliquerait, mais j’étais prête à tout. J’étais plus jeune aussi, car maintenant, même pour moi, ce trajet me semble trop épineux pour qu’un auteur le suive : je conseille aux auteurs de ne faire le pas que s’il est impérieusement nécessaire. Je vous dis une banalité, mais nous savons tous que la littérature est étroitement liée à la langue. En immigrant, vous perdez justement l’outil que vous utilisez le plus; acquérir un autre langage et le maîtriser à la perfection, cela implique non seulement de grands efforts, mais également des renoncements. Je pense qu’aucun auteur ne sera capable des mêmes prouesses à l’écrit dans une autre langue et qu’il n’y a rien qui remplace la dextérité et la facilité à s’exprimer dans la langue maternelle. Dans la nouvelle langue, la forme du texte est toujours pire que dans la langue maternelle. Mais ce que l’on perd d’un côté, on le gagne de l’autre. Si la forme est plus pauvre, le contenu est sûrement plus riche. Et cela vous pousse vers l’avant. On se résigne à ce que la langue de création soit un amas de clichés que l’on apprend petit à petit, avec beaucoup de pratique et d’application. Voilà la tâche que je me suis imposée et que je suis scrupuleusement.
E-B. S. :-Vous avez pratiquement traduit vous-même en français vos textes publiés en Roumanie, à savoir « Tara brînzei » et « Luca, chinezul şi eu ». Parlez-nous de cette expérience de l’autotraduction, telle que vous l’avez pratiquée ou la pratiquez encore. En tant que traductrice de vos propres textes, les avez-vous re-créés, remodelés, voire re-construits en langue-cible, ou bien vous vous êtes imposé un certain parallélisme, une fidélité au texte-source ?
F.M. – Ce choix m’a été imposé par la nécessité. J’ai commencé à traduire mes textes au lendemain de mon arrivée, comme palliatif à la dépression, au manque de confiance qui caractérise chaque immigrant lorsqu’il se réveille dans un bâtiment où il ne comprend ni les sons ni les bruits. Mes livres étaient ce que j’avais amené de plus important dans mes bagages et j’étais pressée de les faire revivre. En les lisant en roumain, je vous avoue sincèrement que je ne les aimais plus : ils me semblaient fades par rapport à la nouvelle réalité et je me demandais, avec grande peine, qui serait intéressé par des histoires qui parlent de la détresse roumaine, à la ville comme à la campagne. La traduction vers le français les a chargés de mystère, les mêmes phrases et images rédigées en d’autres mots parlaient un peu d’autre chose. Le pire était que je savais combien difficile serait de convaincre les éditeurs d’ici de la valeur de mes écrits, s’il y en avait une. Ce que je me suis promis avec entêtement a été de ne rien changer dans mes textes. À part quelques phrases que j’ai ajoutées au Pays du fromage, pour que le lecteur étranger comprenne mieux les affres du communisme, et quelques pages que j’ai supprimées dans Luc, le Chinois et moi, car trop descriptives, j’ai fidèlement préservé l’original. C’est un devoir de respecter l’intégrité des textes : l’auto traduction doit être aussi fidèle que la traduction par un autre, elle doit respecter le texte comme étant celui d’autrui. En me traduisant, je voulais me voir résonner dans une autre langue, mais je ne voulais rien changer, politique que j’ai appliquée pour tous mes livres. La rencontre avec la nouvelle langue s’est produite sur et dans mes textes, car je me réveillais devant la dure réalité que ce qui était beau en roumain ne l’était plus en français. D’autre part, j’étais surprise qu’en français certaines choses peuvent être dites d’une manière plus concise et même plus évocatrice. L’autotraduction n’est pas un jeu de hasard : on sait qu’on perd, mais il faut s’assurer qu’on gagne autant.
E-B. S. – « Tara brînzei », votre premier volume publié en Roumanie, semble reposer sur le cioranien « inconvénient d’être né » dans un pays obscur, auquel l’héroïne a du mal à s’adapter, surtout à ses odeurs très persistantes, comme celle du fromage, leitmotiv du texte. Quittant la capitale à la suite d’une crise maritale et de son licenciement, la narratrice revient dans le village presque désert de ses ancêtres et vit pendant quelque temps dans la maison de ses parents et de ses grands-parents. Tout tombe en ruine autour d’elle, qui s’engouffre dans une sorte de torpeur, d’aboulie d’où rien ne peut la tirer ; elle vit dans un monde de fantasmes où des images d’ancêtres se mêlent à des figures mythiques, dans une tentative d’identification de la jeune femme à ses aïeules, dont la relation de couple était gouvernée par la violence. Tout cela dans un pays fruste où « tout était estimé selon la valeur du fromage et tout sentait le fromage ». Qu’est-ce qui vous a poussée à écrire ce livre, véritable cri d’une inadaptation extrême ?
F.M. – Le pays du fromage a eu une genèse étendue sur plusieurs années et correspond à plusieurs plans artistiques et personnels. J’ai travaillé à ce roman pendant deux ans, mais avec de très grandes pauses, dues au fait que j’étais trop occupée par mon travail au journal et à l’école. J’ai intensifié le travail lorsque j’ai fini mes études, soit après 1997. Comme genre littéraire, je sortais de l’école un peu fatiguée du postmodernisme et du fait que je ne savais pas encore ce que cela voulait dire exactement. Ce que je savais en revanche, c’était que je ne voulais pas être une auteure postmoderne. Après le maniérisme et le mélange surréaliste de ce mouvement, il me semblait que la littérature devait finalement revenir à un réalisme sincère, à des histoires modestes, ouvrant des chemins aux domaines parallèles à la littérature. Il me semblait que l’histoire comme telle devait rester simple en apparence, mais incommensurablement compliquée en profondeur. L’art de l’écrit me semblait prêt à être métissé avec le cinéma, le théâtre, la peinture, et même la politique. La littérature était devenue pour moi le carrefour de tous les arts, car si l’être humain est encore capable de tout dire c’est surtout à travers la parole qu’il le fait. Il ne fallait donc pas appauvrir cet art, mais l’enrichir de choses nouvelles, lui donner une chance par son renouvellement. Je ne sais pas si j’ai réussi, mais j’ai fortement essayé de semer dans mes livres des bribes du passé et de l’avenir, du proche et du lointain, du mien et de l’autre. À cet effet, j’ai profité de mon expérience de journaliste culturelle, en contact avec le milieu artistique mais politique aussi. À l’époque, je touchais à presque tous les domaines artistiques de la capitale roumaine et, de plus, je lisais beaucoup de journaux. Je lis encore la presse avec la passion qu’on met dans un roman policier. J’ai voulu rassembler cette vision globalisante avec une expérience terrestre, charnelle. Les deux se faisaient réciproquement supportables. Quelque farfelu que cela puisse paraître, il me semblait qu’en Roumanie plus qu’ailleurs, les auteurs devaient se faire le porte-parole de la société, de leur génération et de leur peine. Se tenir à côté à l’époque me semblait une lâcheté. Je ne veux pas être une auteure engagée, mais attentive et honnête. En restant passif, on laisse les canailles vous diriger, impunis. Sur le plan personnel, Le pays du fromage est aussi une histoire liée à ma biographie, car le livre a été conçu entre un divorce qui m’a laissée épuisée, et une époque de grande paix. Après de grandes peines, j’ai compris que les ressources sont en nous-mêmes et qu’une femme vaincue est un péché contre le Dieu de la création qui voulait qu’Ève continue à travailler pour nourrir sa progéniture.
E-B. S. :-Quelles ont été les difficultés majeures dans l’activité de traduction de ce roman, auquel la critique québécoise a trouvé une ressemblance avec « Une saison dans la vie d’Emmanuel », célèbre ouvrage de Marie-Claire Blais ? Votre texte, même s’il place l’héroïne dans une atmosphère plus ou moins intemporelle, où les précisions spatiales sont peu nombreuses, donne au lecteur étranger une image de la plaine roumaine et d’une civilisation balkanique en train de disparaître. Certains détails demandent des explications pour les lecteurs qui ne sont pas familiarisés avec cet espace, par exemple la note de la page 96, sur le mot « colac ». Avez-vous buté sur des difficultés insurmontables ou bien cette opération s’est passée sans beaucoup de contraintes ?
F.M. – La manière de laquelle j’ai mené cette bataille de conquérir le public québécois me semble maintenant une étrange contradiction. Je voulais désespérément publier dans ce pays, car cela était mon but déclaré dès mon départ. J’aurais pu rentrer évidemment, le retour au pays ne m’aurait pas affectée personnellement, mais cela aurait été la preuve que mes livres ne valaient rien. Cela aurait été le plus dur à supporter, car autrement je n’ai jamais été sensible aux on-dit. Je travaillais, donc, avec acharnement à la traduction sans jamais penser que peut-être, pour réussir, il aurait fallu réinventer et réécrire. Je n’ai jamais pensé à trahir mes livres et à me renier moi-même, mon passé et mon vécu. Avec un orgueil dangereux je pensais que le public devait être amené vers ces livres sans détour et sans concession à la mode littéraire. À quarante ans, plus chevronnée et moins naïve, cette rigidité me surprend. Toutefois, je ne ferais jamais autrement. À l’apparition de mon deuxième roman, Luc, le Chinois et moi, j’ai failli rompre avec mon éditeur. Il voulait que je renonce aux chapitres concernant l’histoire du journal. Lui, il était intéressé par la réception critique, moi par la fidélité. Je lui ai dit que tout ce que je pouvais faire était de réduire de quelques paragraphes, mais que le roman resterait tel quel ou on ne le publierait pas du tout. Je pense que la bonne réception d’un auteur tient aussi de sa dignité à défendre ses livres. Tôt ou tard, on arrive à regretter la trahison, les retouches, la concession. S’il n’est pas trop tard, un écrivain arrive à comprendre qu’il a aussi un devoir, et que l’honnêteté est son plus grand allié. Je ne ferai jamais rabais de mon identité, la vraie.
E-B. S. : – Le dernier en date de vos ouvrages, « La reine et le soldat », est en même temps le premier d’une série (que nous vous souhaitons très longue !) où vous vous attachez à écrire directement en français. En lisant ce superbe roman on ne peut pas rester indifférent à la minutie et à la majesté de la reconstitution historique, à la mise en parallèle du passé et du présent, à ce face à face permanent entre Orient et Occident. En fait, vous y reconstituez avec les moyens du prosateur une époque ancienne de l’histoire des Perses, immédiatement après la conquête du pays par Alexandre le Grand. Sur cette toile de fond se déroule la rencontre des deux personnages, la reine Sisyggambris, mère de Darius, et le jeune soldat grec Polystratus, chargé de la garde du palais et donc des appartements de la reine. L’attraction entre les deux est inévitable, car la reine, même vieille femme, symbolise aux yeux du soldat rustre et mal odorant le comble du raffinement oriental, alors que pour elle, il représente la force virile du conquérant. Votre roman joue également sur le parallélisme entre passé et présent et de nombreux clins d’œil renvoient à l’actualité du début de ce millénaire, comme la guerre en Irak (« Alexandre délivrait des peuples qui ne voulaient pas être délivrés…Ceux qui s’avancent trop sur le territoire des autres ne sont en aucun cas des libérateurs », p. 139) ou comme ce terrible « clash » des civilisations, qui oppose de plus en plus Occident et Orient. Est-ce que votre première expérience comme écrivain de langue française s’est complètement passée du soutien de votre langue maternelle ? Avez-vous complètement renoncé à l’autotraduction pour « La reine et le soldat » ? Quels ont été les défis d’une telle rédaction ?
F.M. – Pour ce roman, j’avais un petit noyau de cinquante pages environ en roumain. J’ai commencé ce livre à l’époque de mes études en néerlandais, lorsqu’un de mes professeurs m’a donné en cadeau le livre de Louis Couperus, Iskenderun. Aucun Occidental ne peut se passer de cette vision glorieuse du grand conquérant qui avait poussé les limites du monde connu, et à qui on attribue les atours d’un civilisateur. Je me plaisais à ce travail de glorifier un héros. Au Québec, pendant les trois premières années, j’ai laissé de côté ce roman, car je n’avais pas le temps de m’y pencher. J’étais occupée avec mes études de maîtrise et aussi avec la traduction de mes propres livres. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi j’ai recouru à cette stratégie de publier d’abord les œuvres roumaines, en traduction. Peut-être que d’une certaine manière je voyais mes anciens livres comme des pions de sacrifice, je savais que même si la réception était bonne, cela ne voulait pas dire grand-chose pour moi. Entre temps, il y a eu le 11 septembre, la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak. En plus, ma vision d’immigrante, de quelqu’un appartenant aux communautés culturelles, aux plus faibles, avait changé ma manière de regarder Alexandre. Mon amour pour lui avait flétri. Il ne me semblait rien d’autre qu’un aventurier, car de sa campagne en Asie rien n’est resté à part quelques toponymes. La gloire d’Alexandre est due à cette tragique réalité que l’histoire est écrite par les vaincus, et que pour envahir et détruire les plus faibles on n’a besoin que d’un insignifiant prétexte. De retour de Chine, j’ai recommencé ce livre avec grand appétit, renonçant à beaucoup de détails du projet originel. J’en savais plus qu’avant sur ce monde. Si ce n’est que pour ces expériences, mon départ de Roumanie vaut le coup. Dans ce roman, je pouvais maintenant parler de l’Asie, comme je l’ai perçue en Chine, de mon expérience d’immigrante et du travail d’embrasser une autre langue, de ma révolte et de mon impuissance, de ma colère. Ça a été un drôle de spectacle de voir que tous savent, qu’on s’indigne devant la télé, mais qu’on ne peut rien faire contre les agresseurs. Ce roman a été mon humble protestation. Elle est peut-être difficile à repérer dans le luxe de la description, mais elle est toujours là.
E-B. S. – Une dernière question, portant maintenant sur l’avenir : quoi de neuf dans votre chantier de travail ? Quels nouveaux titres réservez-vous à vos lecteurs, que ce soit au Québec, en Roumanie et dans tout le monde francophone ?
F.M. – Je me considère une auteure heureuse, car j’ai encore plein d’idées, mais je n’ai pas assez de temps pour les réaliser. Cela me stimule cependant, car rien n’est plus grave qu’un auteur sans idées. Mes projets d’avenir sont évidemment rédigés directement en français. J’attends encore le verdict de mon éditeur sur Sweet, Sweet, China qui devrait paraître au mois de novembre de cette année, mais on ne sait jamais. Ensuite, je travaille à un roman qui s’appelle Dina, et qui est encore une fois lié à la Roumanie. Mais comme je le disais, je ne renoncerais jamais à un livre qui vient vers moi avec générosité et beauté, pour la raison que la Roumanie est loin du Canada et que cela pourrait ne pas intéresser le public d’ici. Je suis sûre qu’un bon livre intéresse toujours. Mon seul souci est donc de faire de mon mieux. Je ne peux nier ce que je suis, car les autres le savent autant que moi. Au mois de mars, je suis allée en Italie, à l’Université de Calabre, invitée par Gisèle Vanhese, une personne remarquable, également aimante de la culture roumaine et française. À cette occasion, j’ai pu participer à un colloque dans un village d’Albanais, réfugiés en Italie au XV-ème siècle pour fuir l’Empire Ottoman. Le sujet de ce colloque était principalement axé sur la tradition balkanique, en l’occurrence une fameuse ballade populaire albanaise, Constantin et Doruntina. Nous avons été surprises, Gisèle et moi, de constater combien j’étais encore liée à cette tradition balkanique. Comme preuve, dans mon dernier roman j’utilise une phrase issue du roman d’Ismail Kadare, Qui a ramené Doruntina, qui parle justement de la légende d’une sœur ramenée à la maison par le fantôme de son frère. Gisèle, avec son œil de spécialiste, a décelé plus que moi mon vrai filon. Même les questions de ses étudiants m’ont aidée à savoir qui je suis vraiment. Mes projets seront donc en accord avec cette tradition, et avec ce qui s’y ajoutera en cours de route.
E-B. S. – Au nom des lecteurs d’ATELIER DE TRADUCTION, un grand MERCI, Felicia Mihali !
Publié dans la revue ATELIER DE TRADUCTION, Les Éditions de l’Université de Suceava, avec le soutien de l’AUF et de l’Union Latine, no. 7, 2007, p.15
Par Elena-Brandusa Steiciuc